Dissertations corrigés de philosophie pour le lycée
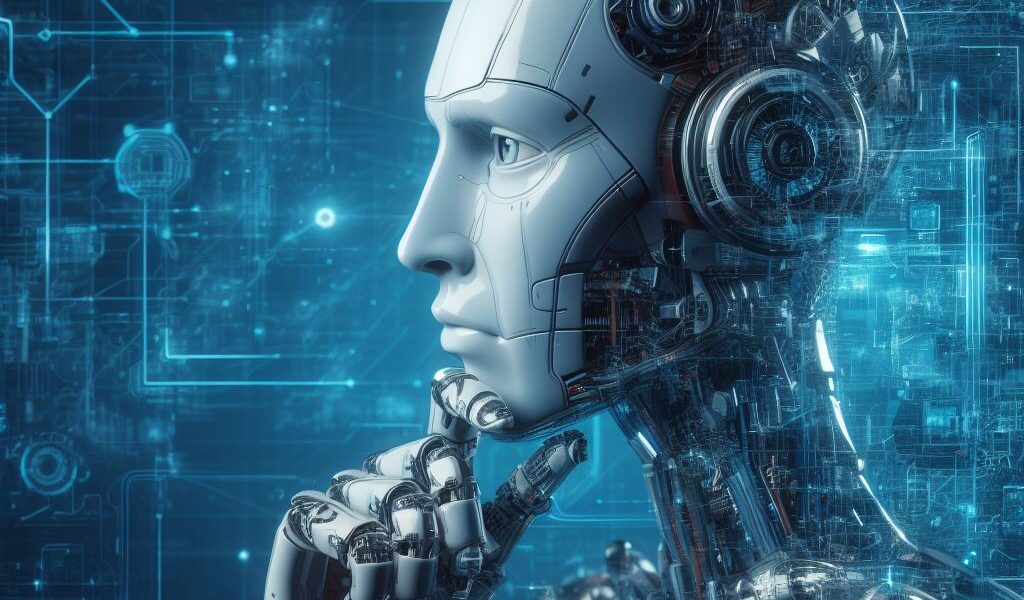

La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ?

La question de la conscience de soi et de la connaissance de soi est un sujet fondamental en philosophie. Cette question nous invite à réfléchir sur la nature de notre conscience et sur la manière dont nous nous percevons. La conscience de soi est-elle synonyme de connaissance de soi ? Ou y a-t-il une différence entre les deux ? Cette dissertation explorera ces questions en définissant et en explorant le concept de conscience de soi, en analysant la relation entre la conscience de soi et la connaissance de soi, en examinant les limites et les obstacles à la connaissance de soi à travers la conscience, et enfin en considérant la conscience de soi comme un outil d’amélioration de la connaissance de soi.
I. Définition et exploration du concept de conscience de soi
La conscience de soi peut être définie comme la capacité à se reconnaître comme un individu distinct, à être conscient de ses propres pensées, sentiments et actions. Elle implique une certaine introspection, une certaine réflexion sur soi-même. C’est ce qui nous permet de dire « je » et de nous distinguer des autres et du monde qui nous entoure.
Selon le philosophe René Descartes , la conscience de soi est une caractéristique fondamentale de l’être humain. Dans ses Méditations Métaphysiques, il écrit : « Je pense, donc je suis ». Pour Descartes , la pensée est la preuve de notre existence et de notre conscience de soi.
Cependant, la conscience de soi ne se limite pas à la simple connaissance de notre existence. Elle implique également une certaine compréhension de nos propres caractéristiques, de nos forces et de nos faiblesses, de nos désirs et de nos peurs. En d’autres termes, la conscience de soi est également une forme de connaissance de soi.
II. Analyse de la relation entre la conscience de soi et la connaissance de soi
La conscience de soi et la connaissance de soi sont étroitement liées, mais elles ne sont pas identiques. La conscience de soi est une condition préalable à la connaissance de soi. Sans conscience de soi, il serait impossible de se connaître. Cependant, la conscience de soi ne garantit pas la connaissance de soi.
La connaissance de soi va au-delà de la simple conscience de soi. Elle implique une compréhension plus profonde de notre personnalité, de nos motivations, de nos valeurs et de nos croyances. Comme l’a écrit le philosophe Socrate , « Connais-toi toi-même ». Cette connaissance de soi nécessite une introspection et une réflexion profondes, et elle n’est pas toujours facile à atteindre.
En effet, nous pouvons être conscients de nous-mêmes sans vraiment nous connaître. Nous pouvons avoir une image faussée de nous-mêmes, nous percevoir de manière inexacte ou incomplète. Par conséquent, la conscience de soi est une étape vers la connaissance de soi, mais elle ne garantit pas cette connaissance.
III. Limites et obstacles à la connaissance de soi à travers la conscience
La connaissance de soi à travers la conscience de soi n’est pas toujours facile à atteindre. Il existe de nombreux obstacles et limites à cette connaissance.
Premièrement, notre perception de nous-mêmes peut être faussée par nos désirs, nos peurs, nos préjugés et nos illusions. Nous avons tendance à nous voir sous un jour favorable, à minimiser nos défauts et à exagérer nos qualités. Cette auto-illusion peut nous empêcher de nous connaître réellement.
Deuxièmement, notre connaissance de nous-mêmes est limitée par notre perspective subjective. Nous ne pouvons pas nous voir de l’extérieur, comme les autres nous voient. Notre vision de nous-mêmes est toujours filtrée par notre subjectivité.
Enfin, la connaissance de soi nécessite une introspection et une réflexion profondes, qui peuvent être difficiles et inconfortables. Comme l’a écrit le philosophe Friedrich Nietzsche , « Celui qui se plonge dans sa propre abîme, celui-là risque de s’y noyer ».
IV. La conscience de soi comme outil d’amélioration de la connaissance de soi
Malgré ces obstacles, la conscience de soi est un outil précieux pour améliorer notre connaissance de soi. Elle nous permet de nous observer, de nous analyser, de nous questionner. Elle nous permet de prendre du recul par rapport à nos pensées, à nos sentiments, à nos actions, et de les examiner de manière critique.
La conscience de soi nous permet également de prendre conscience de nos propres préjugés, de nos illusions, de nos désirs et de nos peurs, et de les remettre en question. Elle nous permet de nous voir plus clairement, de manière plus objective.
Enfin, la conscience de soi nous permet de nous améliorer, de nous développer, de nous transformer. Comme l’a écrit le philosophe John Locke, « La connaissance de soi est le commencement de toute sagesse ».
En conclusion, la conscience de soi n’est pas synonyme de connaissance de soi, mais elle est une condition préalable à cette connaissance. Malgré les obstacles et les limites, la conscience de soi est un outil précieux pour améliorer notre connaissance de soi. Elle nous permet de nous observer, de nous analyser, de nous questionner, de nous voir plus clairement et de nous améliorer. En fin de compte, la connaissance de soi est un voyage, un processus continu d’exploration et de découverte de soi. Et la conscience de soi est le premier pas sur ce chemin.
Autres dissertations à découvrir :
- Dissertations
- La conscience
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site dans le navigateur pour mon prochain commentaire.

plans philo à télécharger pour préparer examens & concours > tous nos plans

Le sujet > La conscience et l'inconscient
voir un extrait gratuit | voir les sujets traités | plans de dissertations | plans de commentaires
Liste des sujets traités

Commentaires disponibles
Votre sujet n'est pas dans la liste ? Obtenez en moins de 72h : - problématique entièrement rédigée - un plan détaillé rédigé complet, avec parties et sous-parties - la possibilité de questionner le professeur sur le plan proposé Prestation personnalisée réalisée par un professeur agrégé de philo
Exemple de sujet : La conscience fait-elle de l’homme une exception ?
En s’appuyant sur la définition de la conscience de soi comme sentiment intime de proximité à soi, il est possible de comprendre que le propre de l’homme est de se vivre selon un certain rapport entre esprit et corps. Plus exactement, il ne s’agit pas tant de savoir si la conscience est une exception humaine en tant que telle (ce qui conduirait à des comparaisons un peu délicates et peu utiles entre l’homme et l’animal) que de savoir dans quelle mesure la conscience, telle que l’homme la possède et en use, fait de lui un être exceptionnel. À cet égard, il faut donc essayer de comprendre comment fonctionne la conscience et ce qu’elle permet pour évaluer ce qu’elle apporte à l’existence humaine. Le problème que vise alors votre analyse du sujet revient à un paradoxe. D’une part, la conscience est, à l’évidence, un mode d’être dont l’homme tire tous les profits puisqu’il évalue au moyen de cette conscience les possibilités de son action. Mais d’autre part la conscience fait découvrir à l’homme ses propres limites et ses impossibilités, c’est-à-dire que la conscience est également le moyen par lequel l’homme se rend compte de la fragilité de son existence. La conscience est-elle le moyen d’un statut exceptionnel de l’homme dans la ... [voir le corrigé complet]
- Introduction
- Table des matières
- Cours de Philosophie
- Lecture suivie
- Bibliographie
Cours de philosophie
La conscience de soi est-elle une connaissance de soi?
12 Déc 2007 par Simone MANON

La conscience est un pouvoir de représentation permettant à l'homme d'avoir la connaissance des choses et de lui-même. Il sait qu'elles existent et il a la connaissance immédiate de sa propre existence ainsi que de ses états et de ses actes. Le terme signifie étymologiquement « avec la connaissance de ». La conscience est un savoir accompagnant la vie, les pensées et les actes d'une personne. C'est même, si l'on en croit Locke, la conscience de soi qui fonde la possibilité de se savoir une seule et même personne tout au long de sa vie. En ce sens il semble y avoir une équivalence entre la conscience de soi et la connaissance de soi.
Pourtant suffit-il de s'apercevoir, de se donner la représentation de soi-même pour prétendre avoir une véritable connaissance de soi ?
La notion de connaissance connote en effet l'idée d'un savoir obéissant à une exigence de lucidité et d'objectivité. Connaître en ce sens consiste à déjouer les puissances trompeuses promptes à abuser l'esprit dans sa recherche de la vérité. La notion connote aussi celle d'un effort d'intelligibilité . Connaître consiste à rendre raison des choses par l'intelligence des causes, celles-ci n'étant jamais données mais découvertes par un exigeant travail de recherche.
Si l'on donne à la notion de connaissance, son sens fort, il ne va donc plus du tout de soi que la conscience de soi soit une connaissance de soi. Le doute s'impose, par ailleurs, car nous faisons souvent l'expérience de l'opacité de notre être. Nous sommes tristes mais nous ne comprenons pas pourquoi, nous sommes traversés par un désir mais il nous étonne. Nous soupçonnons, dans telle situation, qu'il y a en nous quantité de choses dont nous ignorons l'existence et nous découvrons parfois dans la stupéfaction, l'écart existant entre l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et celle que les autres nous renvoient. Pire, nous nous surprenons à nous mentir et à mentir aux autres comme s'il était impossible d'assumer certaines dimensions de notre être. Et il faut souvent la médiation d'autrui ou de certaines épreuves pour nous dessiller et comprendre que nous ne sommes pas ce que nous avions l'illusion d'être.
Il apparaît donc que la conscience de soi, qui est une condition nécessaire de la connaissance de soi, n'en est pas une condition suffisante. La question est alors de savoir pourquoi il en est ainsi. Qu'est-ce qui expose la conscience de soi à l'illusion et la condamne souvent à être une méconnaissance de soi ?
Pour autant, le terme de connaissance est-il approprié pour désigner l'opération permettant de se saisir dans son identité humaine et dans son identité personnelle ? Car le propre d'un sujet est de ne pas avoir la consistance et la permanence des objets. Si la connaissance implique des procédures d'objectivation, n'est-elle pas par principe condamnée à manquer l'identité d'un sujet ? Et qu'est-ce que le sujet ou le moi en dehors de la conscience qu'il a de lui-même ? Une fiction peut-être comme le montre Hume, auquel cas la conscience de soi n'aurait pas d'objet et si elle en a un, elle est disqualifiée par la réflexion précédente dans toute prétention à l'objectivité.
Alors faut-il renoncer à la connaissance de soi-même ou bien faut-il comprendre que l'identité humaine et l'identité personnelle sont plus un projet qu'une donnée ; une décision qu'un être ; une destinée qu'un destin? Si c'est bien ainsi qu'il faut interpréter le « connais-toi toi-même » socratique, cela signifie que seule la conscience d'être un esprit ou une liberté est une véritable connaissance de soi. Mais cette connaissance est une tâche à assumer, non le savoir objectif d'un supposé objet.
I) La conscience de soi est une connaissance immédiate de soi-même et du monde.
La conscience est la modalité d'existence de l'être humain . Dès que la conscience s'éveille c'est le monde qui surgit avec moi et autrui situés en lui. Impossible d'échapper au savoir de sa propre existence, à l'intuition de ses états et de ses actes. Je fais tel geste et même si c'est sous une forme confuse j'en ai conscience. Je m'ennuie dans ce cours et je le sais. Certes la conscience peut être vague, engluée dans les automatismes, reste que dès qu'il y a conscience il y a connaissance. Il y a même sentiment d'être une seule et même personne tout au long de sa vie car étant toujours présent par la conscience à moi-même, je vis la multiplicité et la diversité de mes états comme miens.
La conscience est donc une forme immédiate de connaissance or une connaissance immédiate peut-elle être une véritable connaissance ? Sous sa forme spontanée, la conscience n'est-elle pas exposée au préjugé, à l'illusion, à la naïveté, aux pièges des fausses évidences ? Platon a pointé dans l'allégorie de la caverne les risques d'un rapport au réel non médiatisé par la réflexion et l'ascèse de notre part sensible. Le danger est toujours de confondre l'apparence des choses avec les choses elles-mêmes.
Par exemple, pour ce qui concerne notre question, est-il possible pour un sujet d'entretenir avec lui un rapport soucieux d'objectivité ? N'est-il pas beaucoup trop intéressé à construire une image gratifiante de lui-même pour être le meilleur placé pour se connaître ? Ce soupçon invite à poser la question du statut de l'introspection et à comprendre que sans la distance de l'extériorité et de l'objectivité, il est vain de prétendre à une connaissance objective de quoi que ce soit. Or dans le cas de la connaissance de soi, il est impossible de disjoindre le sujet et l'objet de la connaissance.
De même, peut-il entrevoir que ce moi qu'il a conscience d'être est peut-être introuvable dès lors qu'on se mêle de le chercher sérieusement ? Chacun parle, en effet, spontanément de lui comme s'il était un être ayant une consistance et une permanence propres. Et les illusions intimistes sont monnaie courante. On invoque un « moi profond », qui serait à retrouver derrière les multiples visages que chacun est pour chacun comme si la personne était quelque chose en dehors des rôles sociaux qu'elle incarne, des actes qui la révèlent ou des métamorphoses qu'elle subit. Or la réflexion pascalienne sur le moi nous affranchit de cette naïveté. Le moi est inassignable car tout ce qui le caractérise dans sa singularité concrète est multiple, divers et périssable.
Alors pourquoi ne peut-on pas établir l'équivalence de la conscience de soi et de la connaissance de soi ?
II) Une connaissance non médiatisée n'est pas une véritable connaissance. La conscience de soi est méconnaissance de soi.
Ce développement exige d'exploiter les thèmes suivants :
Pascal et sa critique de l'intérêt ou de l'amour-propre.
Pascal souligne combien la conscience immédiate est investie par des affects, des désirs, des intérêts sensibles. Ses représentations sont construites sur d'autres exigences que le souci de la vérité. D'où les images de soi que chacun construit à son avantage et l'hostilité à l'égard de tous ceux qui dérangent Narcisse dans ses aveuglements.
Cf. Pensée B82 « Notre propre intérêt est encore un merveilleux instrument pour nous crever les yeux agréablement. Il n'est pas permis au plus équitable homme du monde d'être juge en sa propre cause ».
Pensée B 100 : « La nature de l'amour-propre et de ce moi humain est de n'aimer que soi et de ne considérer que soi. Mais que fera-t-il ? Il ne saurait empêcher que cet objet qu'il aime ne soit plein de défauts et de misères : il veut être grand, et il se voit petit ; il veut être heureux, et il se voit misérable; il veut être parfait, et il se voit plein d'imperfections ; il veut être l'objet de l'amour et de l'estime des hommes, et il voit que ses défauts ne méritent que leur aversion et leur mépris. Cet embarras où il se trouve produit en lui la plus injuste et la plus criminelle passion qu'il soit possible de s'imaginer; car il conçoit une haine mortelle contre cette vérité qui le reprend, et qui le convainc de ses défauts. Il désirerait de l'anéantir, et, ne pouvant la détruire en elle-même, il la détruit, autant qu'il peut, dans sa connaissance et dans celle des autres; c'est-à-dire qu'il met tout son soin à couvrir ses défauts et aux autres et à soi-même, et qu'il ne peut souffrir qu'on les lui fasse voir, ni qu'on les voie. C'est sans doute un mal que d'être plein de défauts mais c'est encore un plus grand mal que d'en être plein et de ne les vouloir pas reconnaître, puisque c'est ajouter encore celui d'une illusion volontaire ».
Sartre et la thématique de la mauvaise foi.
Mensonge à soi et mensonge aux autres car il est difficile d'assumer les multiples responsabilités qui nous incombent tant dans notre facticité que dans notre transcendance. Notre liberté nous angoisse et nous expose sans cesse à nous défausser d'une certaine vérité de nous-mêmes parce qu'elle nous dérange. Rien n'est plus inaccessible à l'homme que la sincérité puisqu'il n'existe pas dans l'identité de soi avec soi et l'authenticité n'est pas la vertu la mieux partagée. Il y faut un courage qui fait la plupart du temps défaut. Ici, il est intéressant de pointer cette tendance si courante du sujet à s'identifier à son rôle social. On pense bien sûr à l'analyse sartrienne du garçon de café. Il joue avec un tel sérieux son rôle qu'il se prend pour un garçon de café, qu'il confond sa personne avec son personnage. Et l'on observe que lorsque le rôle est gratifiant, la personne a l'impression de "n'être plus rien" lorsqu'elle en est dépossédée. Drame des disqualifications, de la retraite. "Dans toute carrière publique, une fois que l'on a construit son personnage et que le bruit qu'il fait revient à son auteur et lui enseigne ce qu'il paraît, celui-ci joue son personnage ou plutôt son personnage le joue" Valéry Mélanges.
Freud et le thème de l'inconscient.
S'il est vrai, comme l'analyse Freud, que notre psychisme est pour l'essentiel inconscient, il est clair que la conscience de soi ne peut pas être le moyen de se connaître.
« Le moi en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe en dehors de sa conscience dans sa vie psychique ». Freud montre que la lucidité est barrée par principe car ce qu'il appelle inconscient, c'est l'écart entre le sens que chacun donne consciemment à ses faits et gestes et le sens que ces mêmes faits et gestes ont dans l'interprétation analytique. Seule la médiation d'un analyste permet au sujet de nouer un rapport plus lucide avec lui-même.
Descartes et le thème de l'opacité de l'union de l'âme et du corps, les phénoménologues et le thème de l'opacité du corps.
Etre l'union d'une âme et d'un corps (Descartes) ou être un corps (phénoménologie) c'est vivre d'une vie qui n'est pas transparente à l'entendement. J'ai bien conscience de ma déprime (passion de l'âme) mais sa genèse, les causes qui l'expliquent me demeurent inconnues. Ainsi en est-il chaque fois que mes états ne procèdent pas de l'initiative de ma pensée. Je subis dans la confusion mes états d'âme. Ma seule liberté consiste à me disposer d'une manière raisonnable à leur endroit. Ce que Descartes appelle « faire un bon usage des passions de l'âme». Idem pour ce qui se passe dans mon corps. Pour l'essentiel je l'ignore. J'ai bien conscience de mon corps mais je suis privé de la connaissance de sa vie propre.
Spinoza et le thème du rapport imaginaire à soi-même.
Les hommes ont conscience de leurs actes mais ils ignorent les causes qui les déterminent. Seule la connaissance rationnelle, peut déraciner les préjugés en permettant une connaissance adéquate. L'objectivité, la vérité d'une connaissance sont des conquêtes non des données immédiates.
Sartre et le thème de la nécessaire médiation d'autrui.
Sans la distance que me donne sur moi-même le regard de l'autre, je ne suis guère en situation de rompre l'intimité de moi avec moi afin de me voir comme une conscience peut me voir. Le regard d'autrui en me chosifiant me met en demeure d'advenir à la dimension de la conscience, celle-ci ne s'actualisant que comme mouvement de division, d'écart de soi à soi.
Le thème de la nécessaire médiation des épreuves et du temps.
On peut jouer en imagination quantité de personnages. Celui du héros ou au contraire celui du poltron. On peut rêver disposer d'une liberté sans limites. Seule l'épreuve de la réalité nous permettra de prendre la mesure de notre courage ou de notre lâcheté et de la marge de manoeuvre de notre liberté. Par exemple, je pensais dans les temps heureux de la santé que dans la maladie implacable je demanderais à en finir et je découvre que je lutte pour sauver un ultime éclair de vie ; je pensais que la peur de mourir me rendrait lâche et je me découvre courageux. Je me croyais capable de soulever des montagnes et je m'aperçois que je baisse les bras à la première difficulté.
Cf. St Exupéry dans Terre des hommes: « La terre nous en apprend plus long sur nous-mêmes que tous les livres. Parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil. Il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan dans son labour arrache peu à peu quelque secret à la nature, et la vérité qu'il dégage est universelle. De même l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes » et bien sûr à celui, ici, des conditions concrètes de la connaissance de soi.
Sartre a dit cela aussi, d'une manière terrible pour tous les hommes qui, au lieu de se faire être, se contentent de se rêver. « L'homme n'est rien d'autre que son projet, il n'existe que dans la mesure où il se réalise, il n'est rien d'autre que l'ensemble de ses actes, rien d'autre que sa vie. D'après ceci, nous pouvons comprendre pourquoi notre doctrine fait horreur à un certain nombre de gens. Car souvent ils n'ont qu'une seule manière de supporter leur misère, c'est de penser : « Les circonstances ont été contre moi, je valais mieux que ce que j'ai été ; bien sûr, je n'ai pas eu de grand amour, ou de grande amitié mais c'est parce que je n'ai pas rencontré un homme ou une femme qui en fusse digne (...) Or, en réalité, pour l'existentialiste, il n'y a pas de possibilité d'amour autre que celle qui se manifeste dans un amour (...) Un homme s'engage dans sa vie, dessine sa figure et en dehors de cette figure il n'y a rien » L'existentialisme est un humanisme. 1946.
III) Vanité d'une connaissance de soi qui n'est pas conscience de la distance séparant le sujet de toutes ses expressions provisoires et inaccomplies.
La connaissance de soi est donc une entreprise qui excède les possibilités de la conscience de soi immédiate. Elle requiert de nombreuses médiations et est, au fond, toujours inachevée puisque l'identité d'un sujet n'est pas fixée une fois pour toutes. Elle se construit, se remanie continuellement en fonction des leçons de l'expérience et d'un projet d'existence. L'homme existe et il n'est que ce qu'il se fait, enseigne l'existentialisme. Il s'ensuit qu'on ne peut parler de l'être d'un homme qu'au passé. Oui, il a été ceci ou cela mais impossible de dire ce qu'il est, puisque tant qu'il vit, il peut toujours surprendre et se vouloir autre que ce qu'il fut jusque là. Telle est la condition du pour soi, c'est-à-dire de l'être impuissant à être dans la clôture et la plénitude de l'en soi.
La vraie connaissance de soi n'est donc pas connaissance de ce que l'on est passivement. Certes, une personne intègre de nombreuses données empiriques qu'elle n'a pas choisies. Elle est un homme ou une femme, un blanc ou un noir, un tempérament apathique ou nerveux etc. Il ne s'agit pas de nier qu'il y a des éléments reçus dans l'identité d'un homme. Mais prétendre réduire son être à sa dimension de passivité, c'est s'identifier par sa facticité. Or, on se demande bien ce que peut être un "moi" en dehors de ce qui assure sa continuité, c'est-à-dire en dehors de la conscience qu'il a de lui-même. Un mythe dit Hume et Montaigne, fin analyste de l'expérience humaine avoue: "Je ne peins pas l'être, je peins le passage". C'est dire que toute réification de soi dans l'invocation d'un prétendu être qui serait donné hors de la décision de le faire exister de telle ou telle manière est une stratégie de mauvaise foi. Il n'y a pas de sujet hors de l'opération par lequel il se pose, pas d'identité personnelle hors d'un processus d'identification. Le moi n'est pas un objet qui, hors de soi, serait à connaître, c'est un sujet ne prenant consistance que par le mouvement de nier tout ce en quoi il ne peut pas se reconnaître. C'est dire qu'il n'a pas d'être parce que son être c'est la liberté.
Conclusion :
La conscience de soi n'est pas spontanément une connaissance de soi. Il faut, pour prétendre à une connaissance, quelle qu'elle soit, s'affranchir de tout ce qui aveugle car la lucidité et le souci de la vérité sont des conquêtes. Il y faut aussi de nombreuses médiations.
Mais il convient de ne pas se tromper sur le sens d'une authentique connaissance de soi. Ce ne peut pas être une connaissance de type scientifique car un sujet ne peut pas être objectivé sans être nié. Se connaître revient donc, en dernière analyse, à se réfléchir dans sa dignité de sujet et pour cette opération la conscience suffit, à condition de préciser que cette conscience ne peut pas être la conscience spontanée. Pour qu'un sujet, une conscience ou une liberté puisse faire l'expérience pure de son être, l'ascèse d'une méditation métaphysique est nécessaire. Descartes a donné la mesure d'un tel exercice réflexif.
Et cette méditation a ceci de singulier qu'elle est moins dévoilement d'une essence qu'assignation à une tâche spirituelle et morale.
Marqueurs: amour-propre , condition nécessaire , condition suffisante , connaissance , conscience de soi , conscience immédiate , conscience réfléchie , conscience spontanée , illusion , mauvaise foi , regard d'autrui
Posté dans Chapitre II - Conscience. Inconscient. Sujet. , Dissertations
76 Réponses à “La conscience de soi est-elle une connaissance de soi?”
Cela veut donc dire que si l’on a connaissance de notre misère, cela nous permet d’être grand, mais tout en aggravant notre misère ? Je vous remercie d’avoir répondu.
Bonjour Professeur, Je dois répondre à la question « Jusqu’à quel point nos passions neutralisent-elles notre lucidité? » au sujet du texte de la femme de Sartre qui parle de mauvaise foi. Mais je ne saisis pas le lien entre la passion et la mauvaise foi… Pouvez vous m’éclairez s’il vous plait? Mes félicitations pour ce site et tout le travail que vous avez fourni.
Bonjour Je ne sais pas quelle est la référence fantaisiste dont vous parlez. Pour ce qui est du thème de la mauvaise foi, il suppose la connaissance de l’idée-force de l’anthropologie sartrienne selon laquelle l’homme est fondamentalement libre. L’homme est « condamné à être libre » car par sa conscience, il a la capacité d’échapper à toute forme figée de son être. Ce que dans un esprit hégélien, Sartre établit en approfondissant l’ambiguïté de la condition humaine. L’homme est à la fois une facticité et une transcendance ayant à assumer cette double dimension avec authenticité. Voyez le chapitre consacré à cette idée dans https://www.philolog.fr/ambiguite-de-la-condition-humaine/ Mais il est difficile d’assumer la responsabilité de la liberté, aussi est-il tenté d’échapper à ses multiples responsabilités dans des stratégies de mauvaise foi. Par exemple, comme on le voit souvent au tribunal, il cherche à s’exonérer du mal qu’il a fait en prétendant qu’il était débordé par une pulsion ou aveuglé par une passion. Or écrit Sartre dans « l’existentialisme est un humanisme »: « On peut juger un homme en disant qu’il est de mauvaise foi. Si nous avons défini la situation de l’homme comme un choix libre, sans excuses et sans secours, tout homme qui se réfugie derrière l’excuse de ses passions, tout homme qui invente un déterminisme est un homme de mauvaise foi […] Ainsi, au nom de cette volonté de liberté, impliquée par la liberté elle-même, je puis former des jugements sur ceux qui visent à se cacher la totale gratuité de leur existence, et sa totale liberté. Les uns qui se cacheront, par l’esprit de sérieux ou par des excuses déterministes, leur liberté totale, je les appellerai lâches; les autres qui essaieront de montrer que leur existence était nécessaire, alors qu’elle est la contingence même de l’apparition de l’homme sur la terre, je les appellerai des salauds. Mais lâches ou salauds ne peuvent être jugés que sur le plan de la stricte authenticité. » Bien à vous.
Merci pour votre réponse. Je me référais à un extrait de « L’Être et le Néant », au chapitre 2 l’exemple de la mauvaise foi de la femme face aux avances d’un homme dont elle connait les intentions.
Bonjour Puisque c’est à l’analyse de la coquette que vous faisiez allusion, il faut éviter de parler de « la femme de Sartre » (expression ambiguë s’il en est!) et évoquer cette grande figure de la mauvaise foi qu’est une jeune femme se laissant courtiser mais refusant d’assumer les responsabilités liées à sa facticité en réalisant une fausse unité de soi au niveau de sa transcendance. Bien à vous.
Pourquoi parler de liberté dans le thème de la figure de mauvaise foi dans l’être et le néant?
Bonjour Je ne prends la peine de répondre qu’aux internautes témoignant de la plus élémentaire des politesses. C’est ce qu’il faut vous empresser d’apprendre. Bien à vous.
bonjour, je dois répondre à une question: pour se connaître soi-même, faut-il une mise à l’épreuve ? Malheureusement je ne sais pas trop comment m’y prendre , j’ai un peu de mal à faire le lien entre les deux, pensez-vous pouvoir m’éclairer sur le sujet ?
cordialement, syria touré
Bonjour Désolée, ce site n’est pas un site d’aide aux devoirs. Vous avez tout ce qu’il faut dans les cours pour éclairer votre lanterne. Il suffit de vous donner la peine de les exploiter. Bon travail.
En écoutant un débat sur France 2, débat assez stérile d’ailleurs, une phrase de monsieur Attali m’a renvoyé a un certains nombres d’interrogations qui m’agitent. le passage dure quelques secondes vous pouvez le retrouver ici a la 20e minute très exactement http://www.youtube.com/watch?v=LKSvTxs6yNQ Il dit » si l’on admet pas que l’on est seul et mortel on ne fait rien de sa vie et rien pour les autres » Je trouve cette phrase extrêmement intéressante dans la mesure où j’entends son corollaire c’est parce que j’admets que je suis seul que je vais faire pour/ aider / comprendre les autres. Pourtant j’observe que rien n’est moins vrai. Si il est vrai que je prends conscience (parfois douloureusement) que je suis seul et que donc pour trouver ma place je dois me réaliser et me connaitre (cf : la psychanalyse, les différents programmes de développement personnel, etc…) j’ai l’impression que cette connaissance de soi souvent faites d’incantations est focalisée sur des objectifs utilitaristes, (réaliser mes rêves, souvent mes désirs d’ailleurs,…) totalement individualistes. Et tout au long de ce parcours égocentrique qui vise la connaissance de soi-meme on ne pense jamais l’individu comme la partie d’un tout. Je pense à mon bonheur, ma famille, mes enfants souvent exclusivement après peut être à mon voisin, ma nation, à l’humanité, la planète. La connaissance de soi se résume aujourd’hui pour beaucoup à atteindre des objectifs et à utiliser les meilleurs outils et à être le plus performants pour le faire. Et je dois avouer que cela me peine car pour certains (beaucoup trop je trouve) le vivre ensemble, la gentillesse (mot que je n’ai pas beaucoup vu dans les livres de philosophie d’ailleurs), la bienveillance, l’empathie et la solidarité ne s’inscrive pas dans le projet contemporain de connaissance de soi. Peut-être que l’on a délaissé la connaissance de soi permettant de saisir son identité humaine au profit de celle permettant de saisir son identité personnelle ? Bien à vous, Patrick
Bonjour Lorsque J. Attali exalte la conscience de notre solitude et de notre finitude il n’enferme pas la connaissance de soi dans les limites du projet égotiste. Il s’agit de la conscience de notre condition humaine, de ce qu’il y a d’universellement humain et cette conscience me semble de nature à remettre le moi à sa place dans une réalité dont il n’est qu’un élément que la lucidité invite à ne pas surestimer. Le drame de beaucoup de personnes me semble être d’être obnubilées par leur « cher moi », de ne pas en voir l’étroitesse et le caractère dérisoire. Quelle vanité incarnent à mes yeux toutes les entreprises consistant à faire du moi le centre de ses intérêts! La moindre action, le moindre engagement dans le monde sous la forme d’un métier, d’une responsabilité familiale ou politique exige de s’oublier un peu soi-même pour faire de ceux qui dépendent de nous le centre de notre attention et de nos obligations.
Mais ne pas surestimer ne signifie pas sous-estimer. Chacun est pour lui-même d’une importance capitale, l’enjeu étant de vivre libre et heureux car la servitude et le malheur sont des maux et ces maux sont souvent au principe de la méchanceté. L’essentiel est sans doute de comprendre que la liberté et le bonheur sont des tâches personnelles dont on ne doit pas attendre des autres l’accomplissement. Mais c’est ce que nous avons de meilleur à offrir à ceux avec lesquels nous vivons, qu’il s’agisse du cercle privé ou de la société dans son ensemble. Il s’ensuit que le souci de soi au sens philosophique (qui diffère en nature du sens psychologique) me semble inclure le souci des autres. Bien à vous.
Bonjour, Pourriez-vous me guider sur la différence entre conscience et lucidité ? Merci à vous Cordialement
Bonjour La conscience est la faculté nous permettant de nous représenter les choses. Mais elle n’est pas, par définition, la capacité de se les représenter clairement, objectivement. Ce que connote l’idée de lucidité. Dans son exercice spontané, la conscience est souvent aveuglée, obscurcie par des préjugés, des affects, des intérêts. Elle est ainsi conduite à produire une vision erronée, fantaisiste du réel. Il s’ensuit que la lucidité n’est pas une donnée, c’est une conquête exigeant un travail critique à l’endroit de ses représentations immédiates. Voyez cet article pour avoir une idée de tout ce qui peut obscurcir la conscience et vicier son rapport au réel. https://www.philolog.fr/les-chaines-des-prisonniers-de-la-caverne-platon/ . Bien à vous.
bonjour s je suis un élève terminal ma question est les cours des philosophie c est à. apprendre par cœur ?????
Bonjour Je suppose que votre professeur s’est exprimé sur ce point. Bien sûr que non: un cours de philosophie n’est pas à apprendre par cœur. On attend de vous que vous compreniez les problèmes qui sont posés à propos d’un thème donné, que vous ayez conscience de la nécessité de définir avec précision les termes que vous employez, que vous fassiez l’effort de porter votre réflexion à la hauteur de celle d’un auteur dont vous avez à expliquer le texte, etc. Il s’agit dans cette initiation à la philosophie, d’ouvrir votre esprit grâce à la médiation des grands auteurs, d’acquérir de la rigueur intellectuelle et de comprendre que les choses ne vont pas de soi, comme le croit la pensée immédiate. Ce n’est pas votre mémoire qui est en jeu dans cet exercice, ce sont vos capacités de compréhension. Bien à vous.
Plusieurs fois dans votre développement vous parlez « d’illusion », mais je ne comprend pas vraiment l’importance de ce terme dans votre dissertation, faites vous référence à un nombre de connaissance s’approchant de la sagesse permettant de discerner l’illusion de la réalité, comme le mensonge de la vérité?
Merci à vous Cordialement
Bonjour Votre question est pour le moins surprenante… Le mot illusion est pris dans son sens commun. Etre dans l’illusion, c’est se tromper, prendre des fictions pour des réalités, avoir un rapport imaginaire à quelque chose. Ici, le « quelque chose » est soi-même. Il suffit d’observer les hommes pour constater qu’ils se font souvent un image fausse d’eux-mêmes, une image illusoire. https://www.philolog.fr/erreur-et-illusion/ Bien à vous.
[…] -LA MEMOIRE- -APHANTASIE- -ROLE DE LA MERE- -HYPERSENSIBILITE- -SPORT- -L'ENNUI- -METHODES SOLUTIONS- -ANXIETE- -ASPI- -MANQUE AFFECTIF- Arborescence des futurs. Qui est Vergibération ? – vergiberation 2. » La conscience de soi est-elle une connaissance de soi? […]
bonjour, J’avais un doute. -Lorsqu’on dit que la dissertation ne doit pas être un catalogue d’auteurs,cela signifie-il qu’on ne peut pas avoir de dissertations dont tous les arguments soient tirés d’auteurs?
-Deuxièmement ,comment insère-t-on ces arguments dans le développement? par exemple ,pour le sujet :L’attention est-elle la caractéristique essentielle de la conscience ? Si dans une partie de la dissertation,on explique en quoi l’attention fait partie du concept de conscience et qu’on utilise des arguments avancés par Descartes,doit-on faire comme s’il s’agissait de nos propres arguments puis par la suite dire que le point de vue de Descartes permet d’illustrer «nos arguments»? Merci d’avance.
Bonjour Dire que disserter ne consiste pas à énumérer des pensées d’auteur revient à comprendre qu’on ne pense pas par procuration. Disserter implique d’affronter une question, d’identifier les problèmes à traiter. Dans cet exercice, la connaissance des auteurs aide à élargir son champ de réflexion, à étayer une argumentation qui pourrait rester pauvre tant qu’on est privé d’une initiation philosophique. Les auteurs sont convoqués à un banquet dont vous devez être le maître d’œuvre. La référence à leurs lumières doit donc venir tout naturellement dans le cadre du déploiement de votre propre examen de la question. https://www.philolog.fr/methodologie-de-la-dissertation-philosophique/ Bien à vous.
Serait-il possible de lire la bibiographie en référence à votre dissertation (ou du moins d’obtenir une liste des principaux philosophes)?
D’avance un grand merci,
Cordialement,
Bonjour Il me semble qu’il n’est pas difficile pour vous de constituer cette bibliographie à partir des références indiquées! Ex: Pascal: les Pensées Sartre: l’Etre et le Néant Freud: Abrégé de psychanalyse Descartes: le traité des passions et les lettres à la princesse Elisabeth Spinoza: L’éthique Montaigne: Les Essais Bien à vous.
Bonjour, Je ne comprends vraiment pas la nécessité de philosopher autour d’un fait aussi élémentaire. Pour paraphraser le titre : « la conscience de soi est la reconnaissance de soi ». Mon gamin de trois ans a parfaitement identifié et assimilé la notion de soi et des autres. Il ne se pose pas de questions existentielles, il sait clairement s’identifier. Tout le reste est du verbiage.
Bonjour, Il serait urgent pour vous de réfléchir de manière élémentaire, ne serait-ce que pour éviter des contresens énormes sur les énoncés. La question n’est pas: la conscience de soi est-elle une reconnaissance de soi, ce qui est une formule parfaitement tautologique; mais la conscience de soi est-elle une connaissance de soi, ce qui est une tout autre affaire. Mais encore faut-il avoir l’intelligence des problèmes, ce qui ne semble pas être, à en croire votre propos, la chose du monde la mieux partagée. Bien à vous.
Bonjour, actuellement en terminale ES, nous avons à réaliser une dissertation sur le sujet » la conscience peut-elle me tromper sur moi même ». J’ai plusieurs pistes sur la question mais j’hésite entre parler de la conscience morale, conscience réfléchie et conscience irréfléchie, ou alors de traiter d’une réponse plus tranchée sur le sujet. Dois-je parler de l’inconscient de Freud ou me concentrer sur Descartes? MERCI
Bonjour Ce site n’est pas un site d’aide aux devoirs. Votre professeur a dû vous enseigner la méthode de la dissertation. https://www.philolog.fr/methodologie-de-la-dissertation-philosophique/ Vous devez donc procéder à un traitement dialectique de la question. Ce qui vous imposera de mobiliser et Freud, et Descartes. Vous rencontrerez nécessairement dans le cadre de l’analyse les distinctions entre conscience réfléchie, irréfléchie conscience morale. Bon travail
Laisser un commentaire
Nom (requis)
Mail (will not be published) (requis)
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
Entrées complémentaires
Il n’y a pas d’entrée similaire.

Tous droits réservés.
10 leçons sur : la liberté
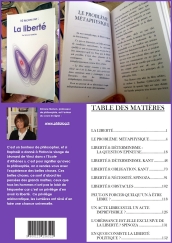
10 Chapitres du cours sur la liberté, sélectionnés et édités dans un format papier agréable et pratique.
Impression à la demande au format poche
Pour Commencer
Comment se repérer dans ce blog ?
Présentation du chapitre I
- Chapitre I – La philosophie.
- Chapitre II – Conscience. Inconscient. Sujet.
- Chapitre III – Autrui.
- Chapitre IV – Désir.
- Chapitre IX – L'art.
- Chapitre V – Bonheur et moralité.
- Chapitre VI – Nature-Culture.
- Chapitre VII – Le travail.
- Chapitre VIII – La technique.
- Chapitre X – La religion.
- Chapitre XI – Le langage.
- Chapitre XII – Le réel, l'expérience.
- Chapitre XIII – La raison.
- Chapitre XIV – L'interprétation.
- Chapitre XIX – Droit et justice.
- Chapitre XV – L'histoire
- Chapitre XVI – La vérité.
- Chapitre XVII – Matière, vie, esprit.
- Chapitre XVIII – La politique.
- Chapitre XX – Etat et Société.
- Chapitre XXI – La liberté.
- Chapitre XXII – Réflexions sur l'Europe
- Chapitre XXIII- L'existence, le temps, la mort
- Chapitre XXIV- L'ennui
- Chapitre XXV. Le plaisir.
- Chapitre XXVI: La guerre.
- Présentation des chapitres
- Dissertations
- Explication de texte
- Méthodologie
Commentaires Récents
- Simone MANON dans Explication de l’allégorie de la caverne
- Antoine dans Explication de l’allégorie de la caverne
- Simone MANON dans Qu’est-ce que l’autorité?
- Simone MANON dans Le populisme.
- Jerome dans Le populisme.
- Emile Durkheim et l’analyse du lien social : De la division du travail social (1893) – Je suis mon monde dans Ambiguïté de la division du travail.
- Grégory Massé dans Qu’est-ce que l’autorité?
- Simone MANON dans Laïcité: une institution désenchantée.
- Noon dans Laïcité: une institution désenchantée.
Articles Récents
- Kant. La condition nécessaire à la possibilité de la paix entre les Nations.
- La dialectique du bourgeois et du barbare
- Charles Stépanoff: L’animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage
- Joyeux Noël.
- Vincent Coussedière. Eloge de l’assimilation
Liens - Chambéry
- Lycée Vaugelas
- Proxy Informatique
Liens - Cuisine
- La cuisine de Mercotte
- Les bonheurs de Senga
Liens - Philosophie
- La république des livres
- La vie des idées
- Le blog de Marcel Gauchet
- Les beaux cours de philosophie de Jacques Darriulat
- PhiloSophie sur l'académie de Grenoble
- Sens Public
- Tumulti e ordini. Le blog de Thierry Ménissier.
- Flux des publications
- Flux des commentaires
- Site de WordPress-FR
PhiloLog © 2024 Tous droits réservés.
Propulsé par WordPress - Thème « Misty Look » par Sadish Proxy Informatique -->

Rechercher dans 504503 documents

Dissertation : La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ?
Publié le 10/04/2023
Extrait du document
« Introduction : La conscience de soi est un concept central dans la philosophie, qui a été exploré par de nombreux penseurs à travers l'histoire. Cette conscience de soi peut être définie comme la capacité de se percevoir soi-même comme un être distinct des autres, avec des pensées, des émotions et des intentions propres. Cependant, la question qui se pose est de savoir si la conscience de soi est une connaissance de soi. Dans cette dissertation, nous allons explorer cette question en examinant les différentes perspectives philosophiques sur la conscience de soi. I. La conscience de soi comme connaissance de soi La perception de soi-même, la réflexion sur soi-même et la compréhension de ses propres expériences sont des éléments qui peuvent être considérés comme des formes de connaissance de soi. La conscience de soi nous permet de percevoir notre propre existence et de nous différencier des autres. Cette perception de soi est un élément crucial dans notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En plus de la perception de soi-même, la conscience de soi implique également une réflexion sur soi-même. En réfléchissant sur nos propres pensées, émotions et actions, nous sommes en mesure d'acquérir une meilleure compréhension de qui nous sommes et de ce qui nous motive. La conscience de soi peut également être considérée comme une forme de connaissance de soi car elle nous permet de comprendre nos propres expériences. En étant conscients de nos pensées et émotions, nous sommes en mesure de mieux comprendre ce qui nous affecte et ce qui nous motive. II. La conscience de soi comme non-connaissance de soi Cependant, la conscience de soi peut également être considérée comme une non-connaissance de.... »
Liens utiles
- Dissertation philosophie Bertrand Russell in Science et Religion: la conscience
- La connaissance de soi peut-elle être sincère ? (dissertation)
- Locke: La connaissance implique-t-elle nécessairement la conscience ?
- La conscience est-elle condition de tout connaissance ?
- La connaissance des lois de l'inconscient nous console-t-elle du désordre de notre conscience ?
Obtenir ce document
Le document : " Dissertation : La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ? " compte 472 mots (soit 1 page). Pour le télécharger en entier, envoyez-nous l’un de vos travaux scolaires grâce à notre système gratuit d’échange de ressources numériques ou achetez-le pour la somme symbolique d’un euro.
Le paiement a été reçu avec succès, nous vous avons envoyé le document par email à .
Le paiement a été refusé, veuillez réessayer. Si l'erreur persiste, il se peut que le service de paiement soit indisponible pour le moment.
Payer par Allopass
Rechercher dans ce blog
Philosagesse.
Le Journal Philosophique de Johan
- Obtenir le lien
- Autres applications
- Conscience/Inconscient/Métaphysique
- L'existence et le Temps
- L'Existentialisme
- La Matière et l'Esprit
- La Perception
- Textes de Johan

La conscience par Descartes - Introduction au thème du « moi »
Commentaires, articles les plus consultés.

L'homme est-il un être à part dans la Nature ?
Suis-je ce que j'ai conscience d'être ? / Qui suis-je ? / Puis-je me connaître ?
- Terminale ES
- Philosophie
- Cours : La conscience
La conscience Cours
La notion de conscience renvoie à deux grandes significations. D'une part, la conscience peut être comprise comme conscience de soi : elle désigne alors la faculté de l'homme d'être conscient de lui-même (de ses pensées, de ses actes), mais aussi du monde qui l'entoure. D'autre part, la conscience renvoie à la conscience morale : elle désigne alors la capacité de tout individu à saisir le bien et le mal.
Introduction à la notion de conscience
La conscience est un terme très utilisé dans le langage courant.
De nombreuses expressions utilisent cette notion dans le domaine de l'action (conscience morale) aussi bien que dans celui de la connaissance (conscience de soi).
On dira que l'on « est bien conscient que... » lorsque l'on veut signifier que l'on connaît les risques ou les conséquences de ce que l'on fait. On fait alors allusion d'une part à la connaissance, d'autre part à la responsabilité. « Être conscient » a donc un sens très large.
À l'inverse, on dira que l'on agit « sans avoir conscience de ce que l'on fait », c'est-à-dire que l'on agit « machinalement », lorsqu'on ne prend pas le temps de réfléchir à ce que l'on fait, en se laissant gouverner par des « automatismes ».
On peut également relever des utilisations de la notion de conscience qui ont un autre sens.
Au niveau d'un groupe comme la société, on parlera de conscience historique ou de conscience politique : on renvoie ici à un groupe d'idées partagées par un ensemble de personnes et relevant de la « conscience collective ».
Enfin, le terme de conscience s'utilise aussi à un niveau moral, comme lorsque l'on utilise les expressions « avoir bonne ou mauvaise conscience », c'est-à-dire se sentir juste ou au contraire coupable, ou bien lorsque l'on dit qu'il faut « juger en son âme et conscience », c'est-à-dire en fonction de critères moraux.
La conscience, dans le langage courant, présente donc plusieurs sens. Peut-on proposer une définition unifiée de la conscience ? Il est en tous cas possible de lui distinguer deux grands sens :
- La conscience psychologique : c'est la capacité de chaque individu à se représenter ses actes et ses pensées.
- La conscience morale : c'est cette sorte de « juge intérieur » à chaque être humain qui lui permet de statuer sur le bien ou le mal.
Ainsi, lorsque l'on dit de l'homme qu'il est conscient, cela signifie deux choses :
- Qu'il se sait en relation avec une réalité extérieure : par l'intermédiaire du corps, des sens, sa conscience lui permet de saisir les objets qui l'entourent.
- Qu'il perçoit aussi une réalité intérieure, subjective : celle de ses états d'âme, de ses désirs, de ses souhaits.
La conscience est la présence constante et immédiate de soi à soi. C'est la faculté réflexive de l'esprit humain, c'est-à-dire sa capacité à faire retour sur soi-même. C'est la conscience qui permet à l'homme de se prendre lui-même comme objet de pensée, au même titre que les objets extérieurs. Ainsi la conscience de soi « accompagne » la conscience « tout court », la conscience du monde extérieur.
La conscience de soi
La conscience de soi, le propre de l'homme.
La conscience de soi comme capacité de faire retour sur soi est une spécificité humaine.
C'est elle qui fonde notamment le sentiment de l'existence et, pour les penseurs modernes, la pensée de la mort.
René Descartes met en évidence cette capacité de l'homme à se saisir comme pensant à travers l'expérience de pensée du cogito (« je pense, je suis »). Recherchant une première certitude, Descartes en vient à mettre en doute toute chose existante, jusqu'à l'existence du monde extérieur, auquel toute chose appartient. C'est au cours de ce doute volontairement généralisé (ou « hyperbolique ») qu'il découvre la première certitude : lorsqu'il va jusqu'à douter même de sa propre existence, il sait qu'il est en train de douter, car le doute est une pensée. C'est exactement ce signe, ce fait de sa pensée qui l'assure de son existence, et que le cogito transforme en certitude : pour penser, il faut être.
Par le mot penser, j'entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous l'apercevons immédiatement par nous-mêmes.
René Descartes
Les Principes de la philosophie , ( Principia philosophiae ), trad. Claude Picot, Paris, éd. frères Delalain (1885)
Le cogito cartésien est le raisonnement par lequel René Descartes aboutit à la définition de la certitude première comme étant celle de la conscience de soi (« je pense donc je suis ») : la conscience de soi appartient à une « chose pensante », l'esprit.
C'est la conscience qui fait découvrir que l'on existe et, plus spécifiquement, que l'on existe comme chose pensante. Cette connaissance doit servir de fondement et de modèle pour toute forme de connaissance. Descartes pose donc l'existence de la conscience comme une première certitude, qui met fin à tout le doute antérieur.
D'autre part, le sujet est capable de se saisir lui-même de manière immédiate . La conscience a donc la particularité de n'avoir besoin d'aucune médiation pour rendre compte d'elle-même : la conscience possède une relation immédiate à elle-même .
La conscience de soi est donc ce sentiment qui caractérise, pour un individu, la certitude de sa propre existence.
Les différentes représentations de soi unies par la conscience
La conscience de soi n'est donc pas un objet : on parlera des objets de la conscience, c'est-à-dire des choses qu'elle saisit, mais pas de la conscience comme d'un objet.
Pourtant, si l'on ne cesse jamais d'être présent à soi-même, pourquoi la conscience ne peut-elle pas acquérir le statut d'objet ? Quelle peut être sa réalité, son statut, si ce n'est pas celui d'une chose du monde ?
David Hume souligne que s'il est certain que la conscience de soi accompagne « toutes » les représentations d'un individu (description que retiendra Kant), on ne saisit jamais le moi seul. Il est en effet impossible de saisir le moi indépendamment de ces représentations, en sorte que l'existence même du moi est incertaine.
Je ne peux jamais, à aucun moment, me saisir moi-même sans une perception, et jamais je ne puis observer autre chose que la perception. Quand mes perceptions sont supprimées pour un temps, comme par un sommeil profond, aussi longtemps que je suis sans conscience de moi-même, on peut dire que je n'existe pas.
Traité de la nature humaine , Traité de la nature humaine , livre I, trad. P. Baranger et P. Saltel, Paris, éd. GF-Flammarion (1995)
En effet, ce qui donne à un sujet le sentiment de son existence, ce sont les diverses perceptions qu'il sent en lui. Ainsi, on ne peut pas dire que l'on existe lorsque l'on dort puisqu'on n'a pas le sentiment – au sens large, la perception – de son existence.
La conscience de soi repose donc sur les diverses représentations et perceptions qu'un individu perçoit en lui. Elle n'aurait pas d'existence en dehors de ces représentations.
La psychologie scientifique, qui se développe à partir du XIX e siècle, va émettre une critique encore plus virulente à l'égard de la notion philosophique de conscience. Pour elle, cette notion (que ce soit chez Descartes ou chez Hume) est trop attachée à celle d'esprit , c'est-à-dire à l'idée d'une réalité spirituelle. Et pour cette raison, elle ne permet pas de traiter scientifiquement de cette réalité qu'est la conscience de soi.
Opposée à cette idée d'une conscience de soi comme sentiment d'existence de soi-même, la psychologie scientifique, incarnée notamment par le courant béhavioriste (comportementaliste) va développer l'hypothèse selon laquelle la conscience de soi repose entièrement sur les mécanismes de fonctionnement du cerveau .
Béhaviorisme
Le béhaviorisme (anglais : behavior, « comportement ») est un courant de psychologie qui affirme que la conscience n'est qu'un mythe. Selon ce courant, l'étude du psychisme ne peut passer que par l'étude des mécanismes corporels, notamment cérébraux, tels qu'ils sont manifestés par les conduites que l'on peut observer, plutôt que par les représentations de la conscience.
Les facteurs influençant la conscience de soi
La conscience face au monde extérieur.
Si la conscience se définit comme conscience de soi, il n'est pas sûr qu'elle puisse être pensée sans la rapporter au monde extérieur qu'elle permet de connaître.
En tout cas, pour avoir réellement conscience et connaissance de lui-même, l'homme a besoin du rapport à autrui : il prend conscience de lui à travers le regard et la reconnaissance des autres.
C'est pour cette raison que des individus isolés, comme Robinson Crusoé, peuvent devenir fous s'ils ne se créent pas une forme artificielle d'altérité.
L'homme a également besoin du rapport aux choses : c'est en particulier dans ses productions ou ses œuvres qu'il prend conscience de lui-même. L'existence d'une extériorité , c'est-à-dire d'un monde extérieur, ainsi que de la confrontation à l'altérité , c'est-à-dire à autrui, sont donc nécessaires à la constitution de la conscience de soi.
La conscience comme intentionnalité
Puisque la conscience se construit d'abord dans son rapport au monde extérieur, il est possible de la définir comme capacité à se rapporter aux objets du monde.
Autrement dit, la conscience ne serait jamais pure conscience de soi, mais toujours conscience de quelque chose . C'est ce que l'on appelle la conscience comme intentionnalité . C'est cette idée que la conscience est toujours conscience de quelque chose qu'elle vise comme son objet que développe Edmund Husserl, à la suite de Franz Brentano.
Le mot intentionnalité ne signifie rien d'autre que cette particularité foncière et générale qu'a la conscience d'être conscience de quelque chose.
Edmund Husserl
Idées directrices pour une phénoménologie , ( Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie ), trad. Paul Ricœur, Paris, éd. Gallimard, coll. « Tel » (1985)
La conscience est toujours conscience de quelque chose. On ne peut donc pas la penser indépendamment des objets qu'elle vise.
Mais la notion d'intentionnalité ne vise pas seulement les objets du monde extérieur.
L'intentionnalité se manifeste, selon Brentano, dans l'amour, la haine, le désir, la croyance, le jugement, la perception ou l'espoir. Il est constitutif de chacun de ces phénomènes qu'il vise un objet. Sans un objet aimé, pas d'amour. Sans un objet de croyance, pas de croyance. Sans un objet jugé, pas de jugement. Sans un objet perçu, pas de perception. Sans un objet espéré, pas d'espoir, et ainsi de suite pour tout acte mental comme relation d'un sujet à un objet.
Pierre Jacob
L'Intentionnalité. Problèmes de philosophie de l'esprit , Paris, éd. Odile Jacob
L'objet visé par la conscience peut donc être un objet immatériel tel que l'amour, l'espoir, la croyance. On le voit, la notion d'objet est ici prise au sens large : il s'agit de tout ce que peut penser la conscience comme différent d'elle-même, qui caractérise un sujet .
Cette conception de la conscience comme intentionnalité a une autre conséquence : c'est que même lorsque le sujet tente de se saisir lui-même comme conscience, c'est toujours un objet qu'il vise. En effet, dans cette situation, le sujet se vise lui-même comme objet.
On le voit, il est impossible de concevoir la conscience (même comme conscience de soi) autrement que comme conscience de quelque chose. Le monde extérieur est donc en ce sens nécessaire à l'existence même de la conscience.
L'influence de la société sur la conscience
Si le monde extérieur est déterminant dans la construction de la conscience de soi, le fait que l'homme vive au milieu d'autres hommes est probablement un fait tout aussi déterminant.
Comprendre comment se forme la conscience nécessiterait de ce point de vue que l'on tienne compte de l'influence de la société sur la perception que l'individu a de lui-même.
Karl Marx relève avec force ce rôle décisif joué par la société : il considère que le système de pensée de chacun est conditionné par ses « conditions matérielles d'existence ». Autrement dit, notre appartenance à une classe sociale déterminée mais aussi à un moment de l'histoire précis détermine en grande partie la perception que l'homme a de lui-même.
Ainsi, pour que l'individu parvienne à une conscience complète et transparente de lui-même, il faut qu'il ait conscience de l'influence du milieu social et historique dans lequel il évolue.
La conscience morale
La conscience morale comme instinct.
Si la conscience est, comme on l'a vu, conscience de soi et capacité de se construire en relation avec le monde extérieur, cette notion désigne également la capacité de chaque individu de saisir par lui-même, par « intuition », les valeurs morales.
Il s'agit dans ce cas non seulement d'une présence de soi à soi-même, mais aussi d'un état moral intérieur à chacun : c'est cet état intérieur que l'on nomme conscience morale .
Jean-Jacques Rousseau est l'un des penseurs qui défend le plus fortement l'idée qu'il existe un sens naturel de la morale , c'est-à-dire une capacité innée à saisir ce que sont le bien et le mal. Avant même que les humains ne vivent dans des sociétés constituées, régies par des lois et où des institutions transmettent des croyances morales, accompagnées de jugements, ils sont capables de sens moral.
Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rend l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions.
Jean-Jacques Rousseau
Émile ou De l'éducation , Paris, éd. Garnier (1961)
Jean-Jacques Rousseau définit la conscience comme un « instinct divin » : c'est un moyen immédiat et infaillible de reconnaître le bien et le mal.
Pour Rousseau, la conscience morale, « instinct divin » qui permet de reconnaître le bien et le mal, est donc innée : elle est renforcée par la pitié , ce sentiment qui fait partager à tout être humain la souffrance d'autrui. Pourtant, Rousseau nous dit aussi que la perfectibilité, c'est-à-dire le développement de la raison, conduit l'homme à l'immoralité . Cela suppose que l'homme vit déjà en société, ce qui corrompt son sens moral.
L'homme est bon naturellement, mais le développement de la raison et la vie en société étouffent ce sens moral. Dans cette situation, c'est à la raison, bien comprise, qu'il appartient de rétablir la moralité : ce sera l'un des buts du « contrat social », la loi corrigeant les effets de l'immoralité entraînée par le développement des sociétés dans l'histoire.
L'universalité de la conscience morale
Si l'on dit que la conscience morale est universelle, c'est parce que la raison, présente en chaque humain, lui indique le contenu de la loi morale.
De ce point de vue, la conscience morale peut être vue comme la volonté d'agir consciemment et librement selon les règles que nous fournit la raison .
Ainsi, pour Emmanuel Kant, la morale repose sur des impératifs catégoriques : ce sont des impératifs qui commandent sans aucune condition. Ces impératifs indiquent à l'homme ce qu'il doit faire. Ces impératifs sont universels : ils s'appliquent à tout le monde, sans exception et sans considération d'aucun intérêt autre que moral.
Impératif catégorique
L'impératif catégorique est un concept de la philosophie d'Emmanuel Kant qui correspond à ce qui doit être fait inconditionnellement et sans autre justification ou intérêt. Seules les actions qui suivent ce principe sont moralement bonnes.
La formulation principale de l'impératif catégorique est la suivante :
Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle.
Emmanuel Kant
Fondements de la métaphysique des mœurs , ( Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ), trad. Victor Delbos, Paris, éd. Le Livre de Poche (1993)
Cette formulation de l'impératif catégorique indique que la raison peut découvrir par elle-même les normes morales qu'elle doit suivre. Ces normes (celles du Bien) se ramènent toutes à la cohérence du principe (universel et inconditionnel) de l'impératif appelé, pour cette raison, catégorique .
Pour Kant, avant d'agir, il faut toujours se demander s'il serait souhaitable que tout le monde agisse en fonction du même principe. Autrement dit, il faut se demander si ce qui motive l'action de l'individu, le principe qui la commande, pourrait être une règle universelle. Dans le cas contraire, il ne peut être qu'hypothétique, c'est-à-dire valable seulement sous condition.
Si l'on s'apprête à mentir, il faut se demander s'il est possible de souhaiter que le mensonge devienne une règle universelle (un principe). Si c'est impossible, alors l'action n'est pas morale. Pour le mensonge, on voit bien qu'on ne peut pas souhaiter que le mensonge devienne une règle générale des relations humaines : aucune confiance ne serait alors possible, et la société serait elle-même détruite dans son principe, ce qui est contradictoire.
Une société où tout le monde ment ou peut mentir à tout le monde ne mérite pas le nom de société, ce qui est contradictoire : donc, on ne peut pas vouloir une société où tout le monde mentirait.
On appelle cette expérience de pensée le test d'universalisation de la maxime de l'action. Il s'agit donc de se demander ici si la règle d'une action, ce qui la motive, est universalisable.
La conscience morale constitue donc cette capacité de l'homme à se demander chaque fois si la règle de son action est conforme au devoir moral, à la loi de la raison.

Dissertations : La Conscience
Sujets de philosophie sur la notion : la conscience.
Voici une liste des principales dissertations de philosophie sur la conscience :
– Je est-il un autre ?
– Peut-on se connaître soi-même ?
– Penser fait-il de moi un sujet ?
– La conscience peut-elle exister hors du temps ?
– La conscience existe-t-elle ?
– Une conscience irresponsable est-elle possible ?
– Suis-je responsable de tout ce que je suis et de tout ce que je fais ?
– Suis-je ce que j’ai conscience d’être ?
– L’homme est-il un roseau pensant ?
– Est-ce dans la solitude qu’on prend conscience de soi?
– Puis-je être coupable sans être responsable ?
– Toute conscience est-elle conscience de quelque chose ?
– Le monde extérieur peut-il être une preuve de mon existence ?
– La conscience d’autrui m’est-elle étrangère ?
– Autrui est-il en ma conscience ?
– Ai-je besoin d’autrui pour croire en l’existence du monde ?
– La connaissance de soi est-elle plus facile que la connaissance des choses ?
– La conscience de la mort est-elle le propre de l’homme ?
– La conscience doit-elle primer sur l’inconscient ?
You may also like
Dissertations : la liberté, corrigés bac philo 2011 / série l.
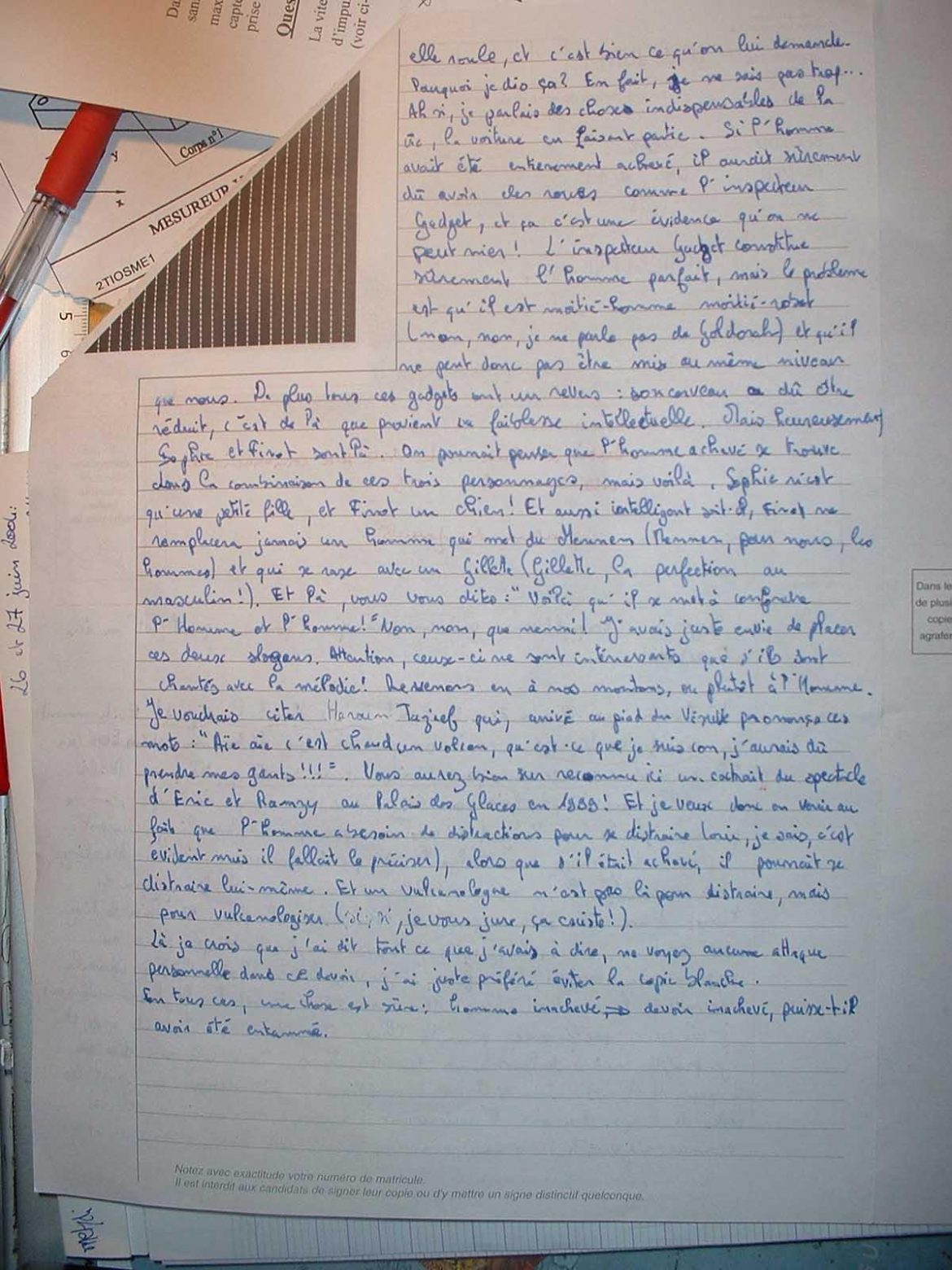
Philosophie et Humour : la copie la plus drôle de la décennie
Que gagne-t-on en travaillant corrigé du bac l 2012, corrigés bac philo 2011 / série es, les sujets du bac philo 2012.
- Ping : exemple de dissertation philo terminale s
Assurément c’est bon. souvent vous octroyez la pensée d’un philosophe à une autre.ce serait bon si vous pouvez corriger cette anomalie.Merci
En quoi la conscience responsabilise t elle l’homme
N’y a t’il que de conscience de soi ?
Sommes nous à l’image de notre conscience?
La conscience responsabilise l’homme dans la mesure où l’homme faire des choses consciemment ou inconsciemment au sein de la société.A titre illustratif je gifle un petit et la trace de mes mains se trouve sur ces joues.
La conscience fonde-t-elle la dignité de l’homme ?
L’homme se réduit-il à la conscience?
La conscience est-elle intentionnelle ?
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
La modération des commentaires est activée. Votre commentaire peut prendre un certain temps avant d’apparaître.
- Archives du BAC (43 534)
- Art (11 062)
- Biographies (6 177)
- Divers (47 456)
- Histoire et Géographie (17 971)
- Littérature (30 273)
- Loisirs et Sports (3 295)
- Monde du Travail (32 158)
- Philosophie (9 544)
- Politique et International (18 653)
- Psychologie (2 956)
- Rapports de Stage (6 975)
- Religion et Spiritualité (1 441)
- Sante et Culture (6 436)
- Sciences Economiques et Sociales (23 576)
- Sciences et Technologies (11 297)
- Société (10 929)
- Page d'accueil
- / Archives du BAC
- / BAC Philosophie
La conscience de soi - Introduction
Par huja • 3 Novembre 2020 • Dissertation • 322 Mots (2 Pages) • 2 101 Vues
La conscience de soi est une notion tout à fait spéciale car il s’agit, non pas de la conscience, cette chose que nous avons tous, qui nous distinguer des autres animaux qui nous fait être ce que l’on est avec une pensée, la conscience de soi est la conscience que l’on a de nous-même, que pense-t-on de nous-même. La présence d’autrui, elle, correspond à quelqu’un qui, quand il se rapproche de nous et de notre conscience, peut avoir ou non un impact sur celle-ci.
On a l’habitude de penser que nous forgeons nous-même notre personnalité et lorsqu’une personne nous affirme que nous sommes un mouton panurge, que nous ne faisons que suivre le troupeau sans prendre aucune décision, nous avons coutume de ne pas l’accepter et de montrer le contraire. En effet notre conscience subit constamment les prises de décision que nous devons prendre chaque jour et celles-ci sont prises en grande majorité en accord avec l’autre, pour ne pas l’offusquer, pour rester en accord avec lui. Cependant, ce type de phrase qui nous agresse nous fait prendre conscience de nous, de ce que nous faisons. Il peut nous faire nous demander si notre conscience d’être, notre conscience d’exister et de penser est seulement due aux actions des autres personnes ou si nous pouvons, volontairement, penser que nous sommes. Autrement dit, la conscience de soi doit-elle quelque chose à la présence d’autrui ?
Pour résoudre ce problème, dans un premier temps, nous nous demanderons en quoi la présence d’autrui n’a pas d’incidence directe sur ce que nous pensons de nous, ceci pour savoir si la présence d’autrui a un impact réel et concret sur nous. Puis, dans une deuxième partie, nous interrogerons dans quelle mesure une autre personne que nous peut avoir un impact sur notre conscience et comment celui-ci agit-il sur notre conscience. Enfin nous verrons de quelle manière autrui doit se présenter dans notre conscience afin de se rendre conscient ou non.

- Recherche par auteur ou oeuvre
- Recherche par idée ou thème
- Recherche par mot clé
- Détecteur de plagiat
- Commande & correction de doc
- Publier mes documents
Consultez plus de 219150 documents en illimité sans engagement de durée. Nos formules d'abonnement
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Commandez votre devoir, sur mesure !
- Philosophie, littérature & langues
- Philosophie
- Dissertation
La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ? - Introduction et plan détaillé
Thèmes abordés.
Conscience de soi, connaissance de soi , Hegel , Descartes , conscience immédiate, dignité de l'être humain, inconscient psychique, inconscient
Résumé du document
Pour aborder ce sujet, l'étudiant doit nécessairement définir la conscience de soi puis la connaissance de soi pour ensuite analyser la corrélation qui peut exister entre ces deux réalités.
- La conscience de soi
- La connaissance de soi
- Axes d'analyse du sujet
[...] La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ? - Introduction et plan détaillé DISSERTATION DE PHILOSOPHIE SUJET : La conscience de soi est-elle connaissance de soi ? Introduction Pour aborder ce sujet, l'étudiant doit nécessairement définir la conscience de soi puis la connaissance de soi pour ensuite analyser la corrélation qui peut exister entre ces deux réalités. - La conscience de soi peut être perçue dans : La perspective cartésienne comme le résultat d'une démarche intellectuelle (cf. le cogito). [...]
[...] Se saisir comme « je », comme conscience implique-t-il qu'on se connaisse véritablement ? La prétention de l'homme à se connaître est-elle un mythe ou une réalité ? L'analyse du sujet invite à l'adoption du plan dialectique, cela conduit aux axes de réflexion suivants : Axes d'analyse du sujet A. La conscience se dévoile comme lumière, comme souveraine du psychisme humain. Rien ne lui échappe. La référence à Descartes ou aux philosophes de la conscience est inévitable. L'introspection, moyen de connaissance de soi tant décriée, est sans nul doute le premier mode de connaissance de soi car il nous révèle, de façon intuitive, nos états d'âme. [...]
[...] Il faut aussi souligner le fait que l'homme ne se voit pas comme les autres le voient. Voilà pourquoi, avant de prendre certaines décisions, de nombreuses personnes demandent l'avis des autres. Le fait d'être conscient de soi ne veut pas dire qu'on a connaissance de tout ce qui nous concerne. Souvent, il faut l'aide des autres. Cela montre tout simplement les limites de l'homme. Conclusion En conclusion, il pourra montrer qu'être conscient de soi ne signifie pas se connaître, car en l'homme existe des phénomènes irrationnels qui lui échappent. [...]
- Nombre de pages 2 pages
- Langue français
- Format .docx
- Date de publication 23/04/2024
- Date de mise à jour 25/04/2024
Source aux normes APA
Lecture en ligne
Contenu vérifié
Les plus consultés
- Analyse linéaire de l'histoire d'une Grecque moderne de l'abbé Prévost
- Prévost, "Histoire d'une grecque moderne" : résumé
- Michael Morpurgo, "Le roi de la forêt des brumes"
- Agir contre ses propres intentions
- N'est-ce que collectivement que nous pouvons être heureux ?
Les plus récents
- Selon vous, peut-on construire son identité en restant dans sa famille, dans son pays ou est-il nécessaire de partir ?
- Dans quelle mesure la présence d'autrui nous évite-t-elle la solitude ?
- La grève est-elle à vos yeux le meilleur moyen pour faire entendre ses revendications ou pensez-vous que les salariés devraient utiliser d'autres moyens ?
- Theories of institutional design, Social traps and the problem of trust - Bo Rothstein (2005) - Analyse épistémologique
- Sans autrui, puis-je être humain ? - publié le 11/05/2024
Prendre conscience de soi, est ce devenir étranger à soi ?
Dissertation entièrement rédigée en trois parties : I. Prendre conscience de soi c’est produire une identité, II. Mais prendre conscience de soi, c’est devenir étranger à soi, III. La prise de conscience de soi comme mise à l’épreuve perpétuelle de sa liberté
Introduction
Il est fréquent, lorsqu’on entend pour la première fois sa voix enregistrée, de ne pas se reconnaître. Prenant conscience d’une partie de soi, on s’apparaît tout à coup comme autre que ce que l’on croyait. Cette nouvelle apparition de soi à soi n’est-elle pas pour l’homme une énigme ? Prendre conscience de soi n’est ce pas devenir étranger à soi ?
Mais prendre conscience de soi, c’est passé d’une conscience immédiate des choses à une conscience qui se réfléchit, qui se pense pensant les choses. Prendre conscience de soi signifie que l’on diminue la distance qui se trouve entre ce que l’on est et ce que l’on a conscience d’être. On réduit ainsi la part d’inconnu en soi. Dès lors, la conscience de soi permettrait de mieux se connaître, de se maîtriser et donc de se réaliser.
La prise de conscience de soi implique une distance entre ce que l’on découvre être et ce que l’on croyait être. Cette distance est-elle ce qui rend étranger à soi, au risque de perdre ce qui fait l’unité du moi : l’identité ? Ou au contraire cette distance est-elle la condition de possibilité d’une reconnaissance de soi par soi, qui donnerait accès à une existence plus réfléchie et plus libre ?
I. Prendre conscience de soi c’est produire une identité
Prendre conscience de soi, c’est passé d’une conscience immédiate, d’une perception du monde extérieur et de ses différents états à une conscience réfléchie, à une conscience de soi qui se saisit en tant que sujet. Le sujet fonde l’identité d’un individu car il est le principe qui unifie l’ensemble des représentations, des états mentaux d’une même personne. Pour Kant dans l’ Anthropologie du point de vu pragmatique , le pouvoir de dire « je » est constitutif de la dignité humaine. Par cette faculté, l’homme a le pouvoir de se « penser » et pas uniquement comme les animaux de « se sentir ». Si l’homme a une conscience, l’animal, lui, n’a qu’un instinct. Kant explique qu’un enfant commence par parler de lui à la troisième personne, et que la conscience de soi devient réelle lorsqu’il dit « je ». Après cette révélation, l’enfant ne fait jamais marche arrière. C’est ce même « je » qui donne aux différentes représentations une unité, une cohérence. La conscience de soi se fait alors à travers l’activité même de la conscience. Prendre conscience de soi devient la condition de possibilité pour se rapprocher de la réalité, y compris de sa propre réalité.
Celui qui réfléchit sur sa pensée qui cherche à savoir ce qu’il sait de sa conscience quand il pense, apprend au moins une chose : il est un être de pensée. Si l’on entreprend de douter de tout pour trouver une certitude absolue, une seule certitude résiste au doute selon Descartes : nous sommes des êtres pensants car si je doute, je pense et si je pense, alors je suis. Prendre conscience de soi est, en ce sens, prendre conscience de sa spécificité humaine, de sa spiritualité, et non pas devenir étranger à soi. Prendre conscience de soi, c’est devenir pleinement soi en affirmant sa différence radicale avec l’animal : la possibilité de penser et donc de parler.
Prendre conscience de soi serait la condition pour se rapprocher au plus près de soi, pour se réaliser et devenir soi-même. En effet, la conscience de soi est inscrite dans un processus naturel de l’évolution de l’homme qui accède à la pensée et au langage. Mais il s’agit ici davantage un « avoir » conscience de soi donné que d’un « prendre » conscience de soi actif. Que sait-on exactement de lorsque l’on sait qu’on est un être de conscience ?
II. Mais prendre conscience de soi, c’est devenir étranger à soi
Vouloir prendre conscience de soi, c’est s’interroger sur soi, sur ce que l’on peut faire et dire, dont le sens nous échappe parfois.
Les lapsus, les actes manqués, les rêves chez l’homme sain, ou les symptômes psychiques chez le malade amènent Freud à postuler l’hypothèse de l’inconscient. Sans lui, bien des actes, même les plus quotidiens, demeuraient incohérents. Prendre conscience de soi, c’est alors admettre que le sujet n’est pas transparent à lui-même, qu’il y a une part du psychisme à laquelle la conscience n’a pas accès. De ce fait, le sujet ne peut avoir la maîtrise absolue de lui-même ; le « moi », n’a plus qu’une perception incomplète de lui-même, le « moi », écrit Freud dans les Essais de psychanalyse appliquée , « n’est pas maître dans sa propre maison », il devient en ce sens étranger (hors de chez lui) à soi : « Je est un autre ».
« Je est un autre » est une phrase extraite d’une lettre du poète Arthur Rimbaud. Il répond à un professeur qu’il n’entend pas prendre le droit chemin de la société et du travail. Bien au contraire, il s’ « encrapule le plus possible » de manière à dérégler « tous ses sens » pour parvenir « à l’inconnu » et donc se faire « voyant ». Ainsi il entend accéder à l’autre dans son altérité par le chemin inverse d’une connaissance objective. Il prétend qu’il ne pense pas, mais qu’ « on » le pense : le poète est celui à travers qui autrui (les autres hommes, mais aussi le monde) s’exprime. Le poète serait celui pour qui la prise de conscience, matérialisée par la création, passe par une sorte de soi volontaire, une possibilité d’atteindre l’humanité universelle de son moi.
Par rapport aux autres êtres de la nature, l’homme se caractérise par la conscience qu’il a de soi, de son esprit. Cette prise de conscience se fait, explique Hegel dans Esthétique , de deux manières. En théorie, l’homme réfléchit sur lui-même, sur les mouvements de son âme, qu’ils soient provoqués par le monde extérieur ou de son propre fait. En pratique, l’homme prend conscience de lui par son activité, qui est en réalité la marque de son intériorité sur le monde extérieur. Par exemple, un petit garçon prend déjà conscience de lui lorsqu’il lance des pierres dans l’eau et contemple les ronds qu’il fait, son œuvre. Prendre conscience de soi, c’est donc sortir de soi, de sa réflexion pour agir sur le monde : de cette manière, on marque le monde de son activité qui en retour témoigne de ce que l’on est. Ce « travail » établit une distance entre soi et soi, et c’est pourquoi on peut sembler étranger à soi.
Ainsi on ne peut accéder à la conscience de soi par la simple réflexion : une part inconsciente du psychisme échappe toujours à la prise de conscience. La conscience doit se faire autre qu’elle s’imagine être : elle doit s’extérioriser. La conscience doit être pratique ; elle doit être un acte pour pouvoir se saisir dans le monde. En ce sens toute conscience est conscience de quelque chose. Elle est intentionnelle, selon Husserl, c'est-à-dire qu’elle porte en elle l’objet qu’elle vise. Si le passage à l’altérité est nécessaire pour prendre conscience de soi, comment comprendre alors qu’une identité se conserve ?
III. La prise de conscience de soi comme mise à l’épreuve perpétuelle de sa liberté
Prendre conscience de soi consiste à rechercher ce que l’on est, à chercher l’essence constitutive de son identité.
Mais cette essence ne se donne pas spontanément. L’homme existe d’abord, il surgit et se rencontre dans le monde. Il ne se définit qu’après. Sartre caractérise ainsi l’existentialisme dans L’existentialisme est un humanisme . L’homme peut donc tout au long de son existence se redéfinir à chaque instant, et se libérer des déterminismes auxquels il se croit soumis. En effet, la conscience de soi ne se confond pas avec la conscience de quelque chose de soi (ses différentes caractéristiques). L’homme est toujours libre d’agir autrement et de devenir autre qu’il n’est déjà. Que ce soit sa profession, son milieu social, son enfance, il a toujours la possibilité d’agir en fonction d’une nouvelle détermination qu’il crée lui-même : il est toujours libre. Ses passions, quelles que soient leurs causes, ne constituent pas un motif suffisant pour l’empêcher d’agir ou d’être différemment. La mauvaise foi serait de le croire. On ne naît pas lâche ou héros. On le devient, et ce n’est jamais définitif. Prendre conscience de soi serait prendre conscience que l’on reste à chaque instant responsable (capable de répondre à ses actes.
En se libérant du déterminisme – de la croyance au déterminisme -, on s’offre la possibilité d’être toujours un autre que ce que l’on était, un étranger. Mais prendre ainsi conscience de soi renvoie à l’inadéquation de l’homme à lui-même, au décalage entre ce qu’il a projeté d’être et sa situation, et crée un sentiment d’angoisse. L’étranger que l’on peut devenir pose le problème du moi comme identité instable : il inquiète. Comment vivre sans angoisse l’étrangeté de l’homme à lui-même, ce décalage entre ce que l’homme est et ce qu’il devient ? Est-il réduit à vivre dans l’inconscience de lui-même ? Si le décalage entre l’essence et l’existence peut répondre à une nécessité morale, sur un plan psychologique, en revanche, l’homme peut faire durer les différents instants les uns par rapport aux autres. La conscience de soi consiste pour Bergson en une attention soutenue entre le passé dont il se souvient et l’avenir qu’il anticipe. La conscience est « un pont jeté entre l’avenir et le passé », écrit-il dans L’Energie spirituelle . Ainsi prendre conscience de soi serait devenir étranger à soi dans la mesure où la conscience de soi c’est l’expérience même de l’énigme du temps. Mais l’identité est préservée car elle se perpétue et se reconstruit perpétuellement tout au long de la vie.
La prise de conscience de soi engage l’action et la possibilité d’agir sur soi librement, de se transformer. Dès lors, le soi est toujours autre mais, à travers ce changement, l’identité constitue ce qui lie les différentes déterminations du soi entre elles. C’est en ce sens que la prise de conscience de soi engage la responsabilité, la possibilité de répondre de ses actes, passés et à venir.
L’énoncé du sujet posait un problème épistémologique : comment la conscience peut-elle être à la fois sujet et objet de sa réflexion sans perdre sa spécificité, son identité ? Ce problème s’est déplacé en difficulté psychologique : le psychisme est double car il ne se réduit pas à la conscience ; une part obscure rend chacun étranger à lui-même. Le problème ne se comprend finalement que métaphysiquement : le sujet conscient se définit par sa temporalité et par son inscription dans l’action qui le renvoie à sa liberté.
Corrigés liés disponibles
Les corrigés similaires disponibles
- La conscience de soi est-elle une connaissance de soi ?
- Bergson, L'Energie spirituelle: "Conscience est synonyme de choix"
- Est-ce dans la solitude que l'on prend conscience de soi ?
- Qu'est ce que prendre conscience ?
- La conscience immédiate est-elle connaissance de soi ?
Autres corrigés disponibles sur ce sujet
- Corrigé élève de jojolapatate
Proposez votre corrigé pour ce sujet
La conscience de soi implique-t-elle la connaissance de soi ?
Perspectives : L’existence humaine et la culture - La connaissance
Introduction
L’expression "se lever du pied gauche" renvoie à l'idée qu’une personne se soit réveillé de mauvaise humeur et passe une mauvaise journée sans savoir quelle est la cause de son mal être. Ainsi malgré le fait que cet individu soit conscient de lui-même comme la plupart des individus et contrôle son corps et ses émotions, il reste une part d’ignorance, ce mauvais réveil est-il du à une mauvaise nuit, ou est-il le symptôme d’un mal être plus profond dont la mauvaise nuit ne serait que la partie visible ?
Définition des termes et problématisation
La conscience de soi est une intuition immédiate et permanente de notre vie intérieure qui rassemble nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos désirs etc.… ils nous sont immédiatement donnés et sont vécus par nous-mêmes et par personne d’autre. Il semble alors possible d’affirmer que nous nous connaissons, et plus encore, que nous sommes les seuls à pouvoir nous connaitre. Cependant, certains faits peuvent nous faire douter de ce constat. La connaissance que l’on a de nous-mêmes peut en effet être incomplète même si la conscience que nous avons semble complète. Certains sentiments qui prennent une ampleur démesurée sans que l’on sache pourquoi, certains désirs qui nous viennent sans raisons visibles sont autant d’exemples de moments pendant lesquels la connaissance de nous-mêmes nous manque. Ces exemples viennent souligner notre non connaissance des causes de certains de nos mécanismes internes. Si l’on convient que la connaissance revient à chercher la réalité profonde des chos...

COMMENTS
LE SUJET- La conscience. Intro à la notion de conscience. Def : - Conscience:signifie étymologiquement « accompagné de savoir ». On distingue conscience psychologique et conscience morale. - Conscience psychologique/ de soi : faculté de l'homme à être conscient de lui-même (de ses pensées, de ses actes), mais aussi du monde qui l'entoure.
La conscience de soi comme outil d'amélioration de la connaissance de soi. Malgré ces obstacles, la conscience de soi est un outil précieux pour améliorer notre connaissance de soi. Elle nous permet de nous observer, de nous analyser, de nous questionner. Elle nous permet de prendre du recul par rapport à nos pensées, à nos sentiments ...
Corrigé de la dissertation de philosophie, disponible gratuitement, et rédigé par l'élève lydianos. Premium. Compte. Français: Commentaires; Philosophie: Philo ... avoir conscience de soi et des autres apporte une meilleure connaissance de soi car on a alors une base de comparaison et l'on peut faire un retour qui nous permet de nous ...
Hegel, Phénoménologie de l'Esprit, Introduction Hegel, Phénoménologie de l'esprit, Conscience, La Certitude sensible Marx & Engels, remettre la conscience à sa place Sartre, L'Être et le Néant (1943), Tel, Gallimard, p. 88.
Dissertation de Philosophie (corrigé) Introduction. Le monde est tout ce qui se présente comme en dehors de soi grâce à la conscience. La conscience implique le fait de distinguer un sujet qui fait l'expérience de la pensée et d'un objet de la pensée.
Mémoire, conscience de soi et identification de soi. On peut faire deux affirmations préliminaires concernant la pensée consciente de soi : qu'elle porte sur soi, et qu'elle implique de penser à soi d'une manière distinctive telle, qu'on ne peut penser à rien d'autre de cette manière.
Mais cette connaissance est une tâche à assumer, non le savoir objectif d'un supposé objet. I) La conscience de soi est une connaissance immédiate de soi-même et du monde. La conscience est la modalité d'existence de l'être humain. Dès que la conscience s'éveille c'est le monde qui surgit avec moi et autrui situés en lui.
Cette conscience de soi peut être définie comme la capacité de se percevoir soi-même comme un être distinct des autres, avec des pensées, des émotions et des intentions propres. Cependant, la question qui se pose est de savoir si la conscience de soi est une connaissance de soi. Dans cette dissertation, nous allons explorer cette ...
Mais l'important dans la réflexion sur la conscience, c'est de ne pas confondre conscience de soi et connaissance de soi. En effet, avoir conscience de soi, c'est savoir que l'on existe et savoir que le monde est, sans pour autant pouvoir se connaître dans l'absolu. Malgré sa conscience, on peut se tromper sur la nature de son propre être.
Conscience. La conscience est la présence constante et immédiate de soi à soi. C'est la faculté réflexive de l'esprit humain, c'est-à-dire sa capacité à faire retour sur soi-même. C'est la conscience qui permet à l'homme de se prendre lui-même comme objet de pensée, au même titre que les objets extérieurs.
L'expérience de la prise de conscience suffit à montrer que nous ne nous connaissons pas entièrement, mais aussi que cette méconnaissance est surmontable. Il est dit que la prise de conscience de soi ne peut être fait dans la solitude. La solitude c'est notre séparation physique ou morale, volontaire ou involontaire avec autrui.
La conscience de soi est la capacité de prendre conscience de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Elle est souvent considérée comme le point de départ pour se connaître soi-même. L'introspection, quant à elle, consiste à se tourner vers l'intérieur de soi pour observer et analyser ses propres pensées et sentiments.
La conscience est donc une activité, elle est un pouvoir de synthèse. Le sujet ne peut prendre conscience de lui-même qu'à travers cette activité. Comme, la conscience de soi ne peut apparaitre que lorsqu'elle se réalise, elle ne peut pas être une connaissance de soi car elle est ce qui permet la connaissance.
Sujet potentiel: Le rapport entre autrui et la conscience de soi. Dissertation: Avons-nous besoin d'autrui pour avoir conscience de nous-mêmes? Introduction. 1ère Thèse: Il est courant de penser, qu'être conscient de soi, c'est éprouver un certain sentiment de son propre être ; en effet, je sais qui je suis et je peux chercher à ...
Dissertations : La Conscience. Sujets de philosophiesur la notion : La Conscience. Voici une liste des principales dissertationsde philosophiesur la conscience : - Je est-il un autre ? - Peut-on se connaître soi-même ? - Penser fait-il de moi un sujet ? [ad#ad-5]
Par huja • 3 Novembre 2020 • Dissertation • 322 Mots (2 Pages) • 2 096 Vues. Page 1 sur 2. La conscience de soi est une notion tout à fait spéciale car il s'agit, non pas de la conscience, cette chose que nous avons tous, qui nous distinguer des autres animaux qui nous fait être ce que l'on est avec une pensée, la conscience de ...
Introduction Pour aborder ce sujet, l'étudiant doit nécessairement définir la conscience de soi puis la connaissance de soi pour ensuite analyser la corrélation qui peut exister entre ces deux réalités. - La conscience de soi peut être perçue dans : La perspective cartésienne comme le résultat d'une démarche intellectuelle (cf. le ...
La pensée est la saisie d'un esprit en mouvement à l'intérieur de soi ou rien. 2. La conscience est ce qui permet le doute. Ensuite, il faut aussi considérer que si l'illusion est un fait de conscience, le doute est ce fait qui met en perspective d'une manière négative son existence.
Mais prendre conscience de soi, c'est devenir étranger à soi. Vouloir prendre conscience de soi, c'est s'interroger sur soi, sur ce que l'on peut faire et dire, dont le sens nous échappe parfois. Les lapsus, les actes manqués, les rêves chez l'homme sain, ou les symptômes psychiques chez le malade amènent Freud à postuler l ...
2. L'acceptation de soi qui répond à l'attente d'autrui est dangereuse pour notre équilibre psychologique. Remarquons dès lors que se faire accepter par soi serait dangereux pour notre santé psychologique. S'accepter soi-même en passant par autrui n'est pas le pur chemin d'un retour à soi.
La conscience de soi est une intuition immédiate et permanente de notre vie intérieure qui rassemble nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos désirs etc.… ils nous sont immédiatement donnés et sont vécus par nous-mêmes et par personne d'autre. Il semble alors possible d'affirmer que nous nous connaissons, et plus encore ...